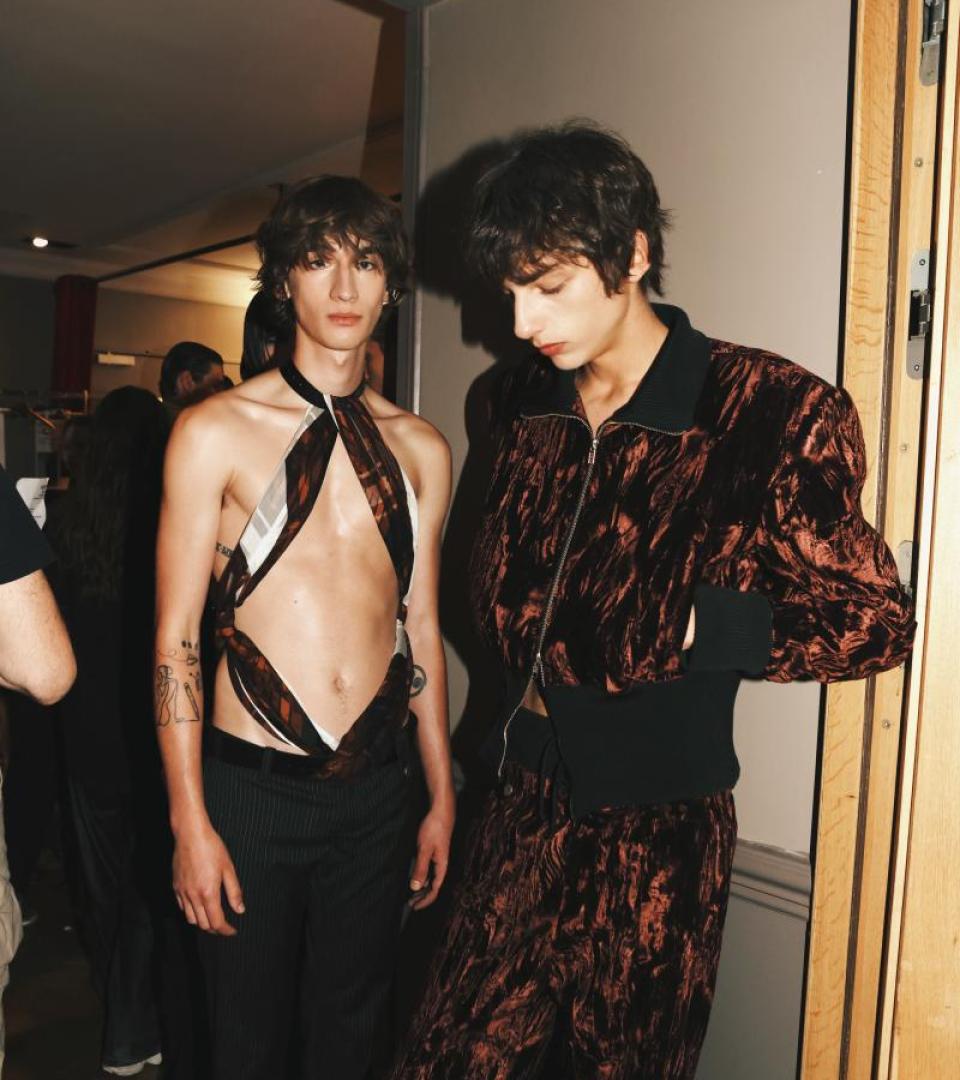Colette Maciet, un parcours exceptionnel dans les coulisses de la Haute Couture
Coco Chanel, Hanae Mori, Karl Lagerfeld, Hubert de Givenchy, John Galliano, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent : Colette Maciet a côtoyé les noms les plus illustres de la mode et de la création. Entrée comme petite main chez Chanel à 14 ans puis première d’atelier des plus grands, elle retrace minutieusement son parcours dans un ouvrage intitulé « Haute Couture », préfacé par Inès de la Fressange, chez l’éditeur Michel Lafon.

©Gilles Maciet
Les paroles de mode sont précieuses. Ce travail d’écriture, de transmission est nécessaire car il permet aux faits d’être incarnés, d’être transmis. Colette Maciet a réalisé ce travail, épaulée par son mari : « Il m’a beaucoup aidé et encouragé, ainsi que mes proches. On me disait que c’était un parcours unique. » Les couturiers et couturières entrent habituellement dans une Maison « et y passent leur carrière, montent les échelons petit à petit », explique celle qui a fait tout l’inverse.
Au début des années 1960, en France, l’école est obligatoire jusqu’à 14 ans. Colette Maciet, après avoir obtenu son certificat d’étude, pressent déjà que la carrière qui lui tend les bras ne pourra pas s’apprendre académiquement. « J’ai dis à mes parents que je ne voulais plus aller à l’école et ils m’ont répondu que je devais travailler. J’avais le choix entre la couture et la coiffure. » Le choix est vite fait. « La sœur de mon père travaillait chez Chanel comme première main qualifiée et a demandé à ce que je rentre comme apprentie. » Colette Maciet passe son premier entretien d’embauche à 14 ans, chez Chanel. « Je n’avais même pas tenu une aiguille avant d’entrer, » confie-t-elle. « J’ai expliqué que je voulais travailler, et c’était bon ! C’est incroyable, on ne rentre pas comme ça aujourd’hui. »
« Mademoiselle Chanel disait qu’on apprend sur le tas. »
Gabrielle Chanel, « Coco », Mademoiselle, a révolutionné la mode en construisant les codes intemporels de l'élégance féminine. Après avoir inauguré sa maison de couture en 1915, elle investit le 31 rue Cambon dès 1918. Le succès est immédiat. Lorsque Colette Maciet rejoint la Maison, la réputation internationale de Gabrielle Chanel a complètement éclos. « J’apprenais en regardant les autres faire. Mademoiselle Chanel disait qu’on apprend sur le tas. » Colette Maciet « observe les couturières travailler », supervisée par « Monsieur Jean », Jean Cazaubon, chef d’atelier tailleur. « Jean a été mon mentor. Il m’a toujours encouragé », confie-t-elle. Colette Maciet progresse et devient première main qualifiée. « Un jour, Jean m’a dit de l’accompagner pour présenter une veste à Mademoiselle. Elle lui a dit « Jean, allez derrière le paravent, je reste avec la petite. » Elle s’est ensuite tournée vers moi et m’a dit : ‘Vous allez faire ce que je vous explique’, et elle s’est mise à couper. » De Gabrielle Chanel, Colette Maciet se souvient d’une grande rigueur, et d’avis tranchés. « Mademoiselle avait horreur des pinces. » se souvient-elle. « J’ai toujours l’habitude de ne pas mettre de pinces, c’est tellement laid », ajoute-t-elle en souriant. « Mademoiselle n’employait que des tissus souples comme le tweed et on plaçait le tissu sur l’organza pour rentrer le tissu de la valeur des pinces. C’était à la fois souple et structuré, sans pinces. Elle avait trouvé quelque chose de fabuleux. »
Le 10 janvier 1971, Coco Chanel tire sa révérence, au Ritz, où elle résidait. Elle avait 87 ans. La collection qu’elle préparait alors a été présentée le 26 janvier à titre posthume, unanimement acclamée par la presse française et internationale. Les membres des ateliers poursuivent dès lors leur travail et continuent d’habiller les clientes, appliquant scrupuleusement les préceptes et volontés que Gabrielle Chanel avait édicté toute sa carrière. « Monsieur Jean m’a ensuite recommandée pour une place première d’atelier dans une autre Maison, chez Hanae Mori. » Nous sommes en 1977 quand Hanae Mori, première créatrice japonaise à défiler à New York deux ans auparavant, présente sa première collection à Paris. Elle devient dans la foulée la première membre japonaise de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Première d’atelier à 30 ans, Colette Maciet y découvre « de nouvelles techniques, une nouvelle approche » et perfectionne son art. « Je dirigeais une vingtaine de filles, je distribuais le travail. C’était la première fois que je faisais des toiles car Mademoiselle ne faisait pas de croquis. C’était un grand changement. »
« Les croquis de Karl étaient si précis, clairs et détaillés. »
Le 15 septembre 1982, Chanel annonce dans un communiqué : « La vie et l’imagination de la collection haute couture Chanel bénéficieront de l’orientation artistique de Karl Lagerfeld à partir de janvier 1983. » La Maison secoue ses plumes et se restructure. « Monsieur Paquito Sala a été nommé au Tailleur et on m’a appelée pour reprendre le Flou », raconte Colette Maciet. Karl Lagerfeld présente sa première collection pour la Maison Chanel le 25 janvier 1983. La collection s’ouvre avec trois mannequins, trois tailleurs, en bleu, blanc et rouge et se déroule sur des airs d’Edith Piaf et de Charles Trenet. « J’ai gardé l’esprit Chanel, mais je lui ai donné un petit côté up to date », indiquait alors Karl Lagerfeld à la presse. La lumière, les clientes, le faste… Et le travail. En coulisses, Colette Maciet et ses équipes s’affairent. « Nous étions en backstage. Il y a toujours des finitions à faire. C’était ma vie, j’ai adoré ça. J’en ai passé, des nuits, à travailler pour les collections. »
« Karl était tellement précis. Tout le monde recevait des croquis très clairs, détaillés. On faisait notre toile. Ensuite, quand on lui présentait, il choisissait le tissu, les boutons… Puis ça partait en manutention et c’était distribué. » résume parfaitement Colette Maciet. « Son défaut, c’est qu’il n’était jamais à l’heure. » Elle y restera jusqu’en 1990. Elle recevait parfois des propositions d’embauche. « Je refusais évidemment les offres. Je ne sais pas si Karl a entendu ces appels, ou si quelqu’un lui a raconté. Mais lui qui a toujours aimé mes drapés, d’un coup, il ne les aimait plus. »
« J’ai habillé Audrey Hepburn, la grande amie de Monsieur de Givenchy.»
En 1952, Hubert de Givenchy quitte Schiaparelli et fonde sa maison de couture, qui rejoindra l’écurie LVMH en 1988. « J’étais triste de quitter Chanel, mais si j’étais restée, je n’aurais jamais connu Monsieur de Givenchy. » Sa voix s’adoucit en évoquant son nom. « Il était tellement généreux, gentil, bien élevé. Il fallait que je descende dire bonjour le matin et si je ne le faisais pas, la secrétaire appelait pour demander si je faisais la tête », se souvient-elle. « On fêtait Noël, on fêtait les Rois. L’approche était facile. » Elle reste quatre ans et demi auprès de Hubert de Givenchy en tant que première d’atelier, à découvrir et comprendre une autre approche créative. « J’ai habillé Audrey Hepburn ! », se souvient-elle. C’était une très bonne amie de Monsieur de Givenchy. Les essayages se faisaient dans les grands salons, ou chez Monsieur, rue de Grenelle. Je suis déjà partie seule en Suisse pour les essayages ».
Hubert de Givenchy se retire en 1995. John Galliano, tornade créative britannique, prend les rênes de la Maison, en un passage éclair Il présente son premier défilé le 21 janvier 1996, à l’hippodrome de la porte d’Auteuil, et entre chez Dior en octobre la même année. « Quand John Galliano est arrivé, tout a changé sauf les équipes. J’ai gardé mes filles » explique-t-elle. Première d’atelier, Colette Maciet se souvient d’un basculement, d’un contraste saturé entre Messieurs de Givenchy et Galliano. « Imaginez-vous une première main à sa table, elles a 50 cm pour travailler. Quand on a dû faire des traines de 4 mètres de long, on a dû s’adapter. », raconte-t-elle « C’était nouveau et c’était bien, c’était une évolution. Dans les ateliers, on travaillait uniquement avec Steven Robinson, son bras droit. C’est lui qui distribuait les croquis. C’était un binôme, ils se complétaient bien. » Chez Givenchy, Colette Maciet assiste ensuite à l’arrivée d’Alexander McQueen. « McQueen savait travailler. Il avait été tailleur et il savait coudre. Et les croquis qu’il donnait étaient bons », tout en évoquant un caractère bien moins tendre que le fondateur de la Maison : « Il criait sur tout le monde », se souvient-elle.
La création de mode est alors en ébullition. Vogue Paris qualifie la Semaine de la Haute Couture printemps-été 1997 de « Big Bang ». Colette Maciet évolue dans un contexte de tourbillons créatifs tous azimuts. Les collections de Martin Margiela et de Comme des Garçons interrogent la création et l’esthétique du vêtement. Elles questionnent également la notion de corps idéal, alors que les débats sur la chirurgie esthétique et la controverse sur les premiers essais de clonage font rage. C’est l’entrée de la Couture spectaculaire, Thierry Mugler présente la collection emblématique Les Insectes. "Ils sont à la fois fragiles, légers et caparaçonnés, tout comme la femme que j’habille", commentait le couturier à l’époque.
« Et Monsieur Saint Laurent a dit ‘Prenez soin de Colette, c’est la prunelle de mes yeux’. »
Un matin, le téléphone sonne : « Yves Saint Laurent cherche une première d’atelier. » Colette Maciet postule promptement et rencontre alors « Madame Muñoz », Anne-Marie Muñoz, figure emblématique de la Maison Saint Laurent qui fut directrice de studio jusqu’au départ d’Yves Saint Laurent en 2002. « Mon premier jour chez Saint Laurent, Madame Muñoz m’a présenté à Monsieur Saint Laurent. Il m’a emmené dans son bureau à côté du studio et a dit, en regardant la directrice de la Haute Couture: “Prenez soin de Colette, c’est la prunelle de mes yeux.” »
Avec Georgette Capelli, également cheffe d'atelier flou, Colette découvre à nouveau de nouvelles méthodes de travail. « Monsieur mettait ses croquis par terre et nous disait de choisir ce qui nous parlait, ce qu’on voulait faire. » se souvient-elle. « Une fois, Georgette et moi avions pris le même croquis. Nos résultats étaient complètement différents. ». Concrétiser un croquis, une idée est un travail de perception, de réflexion, d’analyse. « Je me souviens avoir réalisé une combinaison alors que Monsieur Saint Laurent avait dessiné un manteau du soir. Il a choisi de garder la combinaison dans la collection. Parfois, la première d’atelier peut changer l’idée du créateur. »
Le lundi 7 janvier 2002, Yves Saint Laurent tient une conférence de presse. Quarante-quatre ans après sa première collection « Trapèze », il annonce la fin de sa carrière. « Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. J'ai connu la peur et la terrible solitude. Les faux amis que sont les tranquillisants et les stupéfiants. La prison de la dépression et des maisons de santé. De tout cela, un jour, je suis sorti, ébloui mais dégrisé », déclarait-il.
Au départ de Monsieur Saint Laurent, Colette Maciet travaille brièvement chez Jean Paul Gaultier puis chez Nina Ricci. « J’ai emmené Martine Perez qui faisait partie de mon équipe chez Saint Laurent. Je l’ai faite passée seconde d’atelier. » En 2005, elles lancent l’entreprise Couture & Co Paris, jusqu’en 2019. « Nous avons travaillé avec plusieurs maisons comme Givenchy et Dior. » Lorsque Pierre Bergé fonde le musée Yves Saint Laurent à Marrakech, il se tourne vers Colette Maciet pour reproduire des pièces. La saharienne, la robe Mondrian, « Je lui expliquais que c’était difficile de retrouver ce qui avait été fait il y a trente ans ! ». Un travail faramineux mais tout à fait réalisable pour celle qui n’a connu que la minutie et le détail toute sa carrière. « Les personnes dans le studio retrouvaient certains patronages. Pour les petites pampilles de la saharienne, on a défait celles du modèle et Monsieur Bergé les a fait refaire à Marrakech. Il savait ce qu’il voulait. »
« Tous les grands sont partis. », constate-t-elle après avoir énuméré les noms illustres qui ont jalonné sa carrière. Les idées débordantes d’audace de ces « grands » qu’elle a connu n’ont pu être visibles que grâce au travail des couturières et couturiers, aux différents métiers qui composent un atelier. De ces mains qui concrétisent les croquis et mettent en mouvement les idées.